Note de lecture
- Date de publication
Note de lecture sur l’ouvrage collectif L’adolescente et le cinéma. De Lolita à Twilight, sous la direction de Sébastien Dupont et Hugues Paris. Préface de Serge Tisseron (Toulouse, Érès, coll. « La vie de l’enfant », février 2013).

American Beauty (Sam Mendes, 1999) : © UIP / DreamWorks.
Sébastien Dupont et Hugues Paris dirigent leur second livre sur la thématique de l’adolescence et du cinéma, livre qui rassemble les collaborations d’une vingtaine d’auteurs d’horizons variés : psychologues, psychiatres, sociologues et spécialistes cinéma, tous réunis par leur passion pour le septième art.
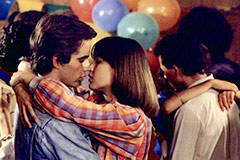 Si leur premier ouvrage[1] avait exploré la question du film culte chez les jeunes, ce nouvel opus s’intéresse plus spécifiquement aux adolescentes. Ce projet original est né du constat des auteurs que leur premier travail, bien que ne s’annonçant pas « androcentré », s’intéressait presque exclusivement à des films de (ou sur les) garçons. Si cette détermination du sexe des spectateurs destinataires des productions cinématographiques mériterait que l’on s’y attarde, L’adolescente et le cinéma vise à combler ce manque, voire à réparer l’oubli.
Si leur premier ouvrage[1] avait exploré la question du film culte chez les jeunes, ce nouvel opus s’intéresse plus spécifiquement aux adolescentes. Ce projet original est né du constat des auteurs que leur premier travail, bien que ne s’annonçant pas « androcentré », s’intéressait presque exclusivement à des films de (ou sur les) garçons. Si cette détermination du sexe des spectateurs destinataires des productions cinématographiques mériterait que l’on s’y attarde, L’adolescente et le cinéma vise à combler ce manque, voire à réparer l’oubli.
En explorant le « continent noir » de la féminité par cet angle original, les auteurs nous offrent un véritable manuel de psychologie et de psychopathologie de l'adolescence féminine, illustré par le cinéma.
Les contributions explorent les rapports entre l’adolescente et le cinéma selon deux approches distinctes :
 Les films sur les adolescentes. Dans l’histoire du cinéma, les adolescentes n’ont d’abord été représentées que dans des seconds rôles qui servaient de faire-valoir à des figures de l’adolescent masculin, rebelle par exemple, comme Nathalie Wood pour James Dean dans la Fureur de vivre (N. Ray). Les réalisateurs les ont ensuite mis en scène au travers de représentations d’adolescentes tentatrices, comme dans Lolita (S. Kubrick) bien sûr, mais également dans Et Dieu créa… la femme (R. Vadim) ou dans American Beauty (S. Mendes). Si ces représentations peuvent être tenues pour la mise en scène des fantasmes des réalisateurs masculins de ces films, l’arrivée des réalisatrices a permis une approche tout à fait différente de la question de la naissance du désir et de la sexualité, dans des évocations aussi variées qu’Une vraie jeune fille (C. Breillat) ou Lost in translation (S. Coppola).
Les films sur les adolescentes. Dans l’histoire du cinéma, les adolescentes n’ont d’abord été représentées que dans des seconds rôles qui servaient de faire-valoir à des figures de l’adolescent masculin, rebelle par exemple, comme Nathalie Wood pour James Dean dans la Fureur de vivre (N. Ray). Les réalisateurs les ont ensuite mis en scène au travers de représentations d’adolescentes tentatrices, comme dans Lolita (S. Kubrick) bien sûr, mais également dans Et Dieu créa… la femme (R. Vadim) ou dans American Beauty (S. Mendes). Si ces représentations peuvent être tenues pour la mise en scène des fantasmes des réalisateurs masculins de ces films, l’arrivée des réalisatrices a permis une approche tout à fait différente de la question de la naissance du désir et de la sexualité, dans des évocations aussi variées qu’Une vraie jeune fille (C. Breillat) ou Lost in translation (S. Coppola).- La seconde approche s’intéresse aux films pour les adolescentes. Ils mettent en scène le corps – ses métamorphoses et ses potentialités séductrices tout autant que destructrices –, depuis l’initiation à la sexualité de Dirty Dancing (E. Ardolino) jusqu’aux risques de rupture identitaire de Black Swan (D. Aronofski) en passant par l’enfantement (cf. Juno, J. Reitman). Néanmoins, là où les auteurs suggèrent que ces thématiques seraient spécifiques à l’adolescence féminine, nous voudrions prolonger leur proposition et voir dans ces représentations la mise en scène de la rencontre, propre à l’adolescence, avec l’autre en soi, l’étranger, c’est-à-dire le pulsionnel. À cet égard, les films d’horreurs figurant des adolescentes « innocentes », poursuivies par d’immonde créatures, se posent comme la mise en scène de la position du sujet face au pulsionnel adolescent, qu’il soit fille ou garçon.
Ainsi, l’analyse psychanalytique des représentations cinématographiques de l’adolescente suggère que le féminin, entendu dans sa dimension pulsionnelle, serait une expérience adolescente universelle.
À tous ceux que la question adolescente intéresse, nous ne saurions que recommander vivement cet ouvrage dont l’originalité et l’iconographie ajoutent une touche ludique à la densité des contributions.
Mélanie Jacquot
melanie.jacquot@unistra.fr
Maitre de conférences en Psychologie clinique
Université de Strasbourg
Faculté de psychologie, EA 3071, 12 rue Goethe, 67000 Strasbourg
[1] Jocelyn Lachance, Hugues Paris et Sébastien Dupont (dir.), Films cultes et culte du film chez les jeunes. Penser l’adolescence avec le cinéma, Québec, PUL, 2009.
Twilight (Catherine Hardwicke, 2008) : © SND / Summit Entertainment
La Boum 2 (Claude Pinoteau, 1982) : © Gaumont
- Date de publication
